QUIZ. Egalité professionnelle : testez vos connaissances !
Dans ce nouveau rendez-vous mensuel, testez vos connaissances sur une thématique qui compte dans le domaine des ressources humaines et du recrutement.
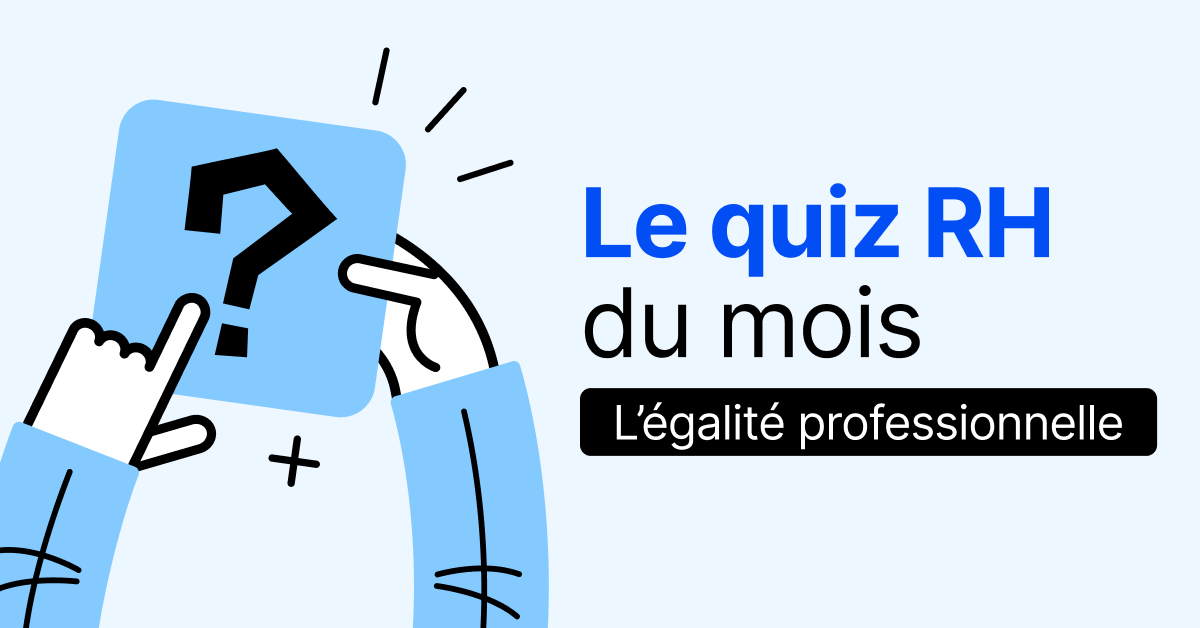
Pour afficher ce contenu issu des réseaux sociaux, vous devez accepter les cookies et traceurs publicitaires.
Ces cookies et traceurs permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d’intérêt.Plus d’infos.
Les réponses
1. Quel est l’écart entre le revenu salarial moyen des femmes et celui des hommes ?
Réponse : 22,2%. Selon les derniers chiffres de l’Insee, les femmes gagnaient en moyenne 22,2% de moins que les hommes, en 2023, dans le secteur privé. A temps de travail identique, cet écart se réduit à 14,2%. L’Insee note que l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes s’est réduit d’un tiers depuis 1995, avec une intensification de cette baisse depuis 2019. La raison ? Des disparités dans les temps de travail entre les hommes et les femmes qui se gomment peu à peu et des écarts de salaire en équivalent temps plein qui se réduisent. D’après une étude de l’Apec, l’écart de salaire entre hommes et femmes chez les cadres, à profil identique, était encore de 6,9% en 2024, un chiffre relativement stable depuis 2019.
2. Quelle part représentent les femmes parmi les salariés à temps partiel ?
Réponse : 77%. C’est une des raisons principales qui expliquent que les femmes gagnent en moyenne moins que les hommes. Selon des chiffres de la Dares publiés en décembre 2024, 77% des salariés à temps partiel sont des femmes. C’est à l’arrivée d’un enfant que les femmes sont plus nombreuses à faire le choix du temps partiel que leur conjoint. Selon l’Insee, 51% des femmes qui travaillent à temps partiel ont fait ce choix pour s’occuper de leurs enfants, contre 14% des hommes.
3. Quel est le métier avec la plus grande proportion de femmes parmi ces propositions ?
Réponse : agent d’entretien. Selon le dernier panorama des métiers de l’Afpa, 95% des agents d’entretien sont des femmes, ce qui en fait l’un des métiers les plus féminisés. Seul le métier de secrétaire compte davantage de femmes encore en proportion, à 96%. Les métiers de la santé sont également très féminisés, avec 91% de femmes chez les aides-soignants et 85% chez les infirmiers.
4. Quelle est la proportion de femmes à occuper des postes à responsabilité ?
Réponse : une femme sur trois. La part des femmes à des postes de management ne cesse de progresser. Aujourd’hui, une femme sur trois occupe une fonction d’encadrement ou de direction, contre une femme sur dix au début des années 1980. Et selon une étude Flashs/Ifop pour Hostinger, publiée en mai 2024, la perception qu’ont les Français des femmes managers devient peu à peu un non-sujet. Pour 70% des personnes interrogées, le fait d’être encadré par une femme ou par un homme n’a aujourd’hui pas d’importance. En 1987, ce chiffre était de seulement 44%. Pour autant, les femmes avec des fonctions d’encadrement, notamment, subissent encore régulièrement des attitudes sexistes en entreprise.
5. Que prévoit la loi Rixain, instaurée en 2022 ?
Réponse : que les instances dirigeantes des entreprises de plus de 1 000 salariés soient composées à 40% de femmes à horizon 2029. Dans les pas de la loi Copé-Zimmermann, qui a amélioré la mixité au sein des conseils d’administration et de surveillance des entreprises de plus de 250 salariés, la loi Rixain, entrée en application en mars 2022, fixe à 40% le seuil minimum de femmes dans les instances dirigeantes des entreprises de plus de 1 000 salariés d’ici le 1er mars 2029. Un seuil intermédiaire doit être atteint d’ici au 1er mars 2026 : 30% de femmes parmi leurs cadres dirigeants et les membres de leurs organes de direction. Mais, selon un rapport de la Cour des comptes remis en janvier 2025, les entreprises concernées ne jouent pas la carte de la transparence au sujet de la féminisation de leurs instances dirigeantes : « Sur les 1 194 entreprises assujetties, seulement 64% ont satisfait à leur obligation de déclaration », relève la Cour des comptes dans son rapport.
6. Quel élément ne rentre pas en compte dans le calcul de l’Index de l’égalité professionnelle que les entreprises de plus de 50 salariés doivent publier chaque année avant le 1er mars ?
Réponse : le nombre de femmes parmi les 5 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations. Les entreprises doivent mesurer le nombre de femmes parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations. Cet indicateur compte pour 10 points, tandis que l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes compte pour 40 points, l’écart de taux d’augmentations individuelles entre les femmes et les hommes pour 35 points et le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé de maternité pour 15 points. Instauré en 2018, l’Index de l’égalité professionnelle est régulièrement critiqué. Dernièrement, la Cour des comptes a regretté que son système de sanctions et de pénalités soit « insuffisamment appliqué » : seules 120 pénalités ont été infligées entre 2021 et 2024.
7. Combien de femmes disent être confrontées fréquemment à des attitudes sexistes au travail ?
Réponse : 79%. Le sexisme ordinaire reste un problème persistant. Selon les chiffres du baromètre #StOpE, publié par l’Association française des managers de la diversité, 79% des femmes affirment que les attitudes sexistes sont fréquentes dans leur environnement de travail. Parmi les manifestations de ce sexisme ordinaire en entreprise, les blagues sexistes : 3/4 des femmes et 2/3 des hommes disent y être exposés. En tant que RH, vous pouvez intervenir en créant un espace de dialogue sécurisant pour que les salarié(e)s puissent signaler ces comportements inacceptables.
8. Quelles sont vos obligations en tant qu’employeur en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ?
Réponse : avoir un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Seule l’existence d’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, désigné par le Comité social et économique parmi ses membres, est obligatoire pour les entreprises de plus de 11 salariés. En revanche, la loi fixe à l’employeur des obligations en matière de santé et de sécurité, qui incluent désormais aussi la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Charge à l’employeur de fixer les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Ces dernières années, de nombreuses entreprises ont ainsi mis en place des process permettant de signaler les comportements problématiques.
9. Que préconise la Cour des comptes pour améliorer l’égalité professionnelle dans son rapport « Les inégalités entre les femmes et les hommes de l’école au marché du travail » ?
Réponse : revaloriser les métiers exercés en majorité par des femmes. Dans le rapport qu’elle a remis en janvier 2025, la Cour des comptes regrette les trop lents progrès permis par les politiques publiques menées ces dernières années en faveur de l’égalité professionnelle femmes-hommes. Pour y remédier, l’institution fait donc un certain nombre de recommandations, parmi lesquelles une meilleure valorisation des métiers exercés en majorité par des femmes en renforçant le rôle du ministère du Travail et de l’Emploi dans la négociation autour des classifications. La Cour des comptes préconise aussi de mettre en œuvre le régime des sanctions prévues par la loi en cas de non-respect des obligations en matière d’égalité professionnelle.
10. Que ne prévoit pas la directive européenne sur la transparence des salaires en faveur de l’égalité salariale entre les hommes et les femmes ?
Réponse : Les entreprises qui ne corrigent pas les écarts de rémunération de plus de 5% entre les femmes et les hommes dans les 3 ans pourront se voir infliger une amende correspondant à 1% de leur chiffre d’affaires. En plus d’imposer aux entreprises de publier sur leurs offres d’emploi une fourchette de salaire, la directive européenne sur la transparence des salaires, qui doit entrer en vigueur au plus tard en juin 2026, prévoit des mesures visant à favoriser l’égalité salariale entre les hommes et les femmes. La directive ne prévoit pas de sanction financière à proprement parler pour les entreprises avec de trop grands écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, mais elle instaure un droit à indemnisation pour les salariés qui s’estimeraient victimes d’une violation du principe de l’égalité des rémunérations.
Guide du recrutement 2026 : l'indispensable pour bien recruter



