Connaissez-vous ces lois en faveur de l’égalité femmes-hommes au travail ?
Et les appliquez-vous toutes ?
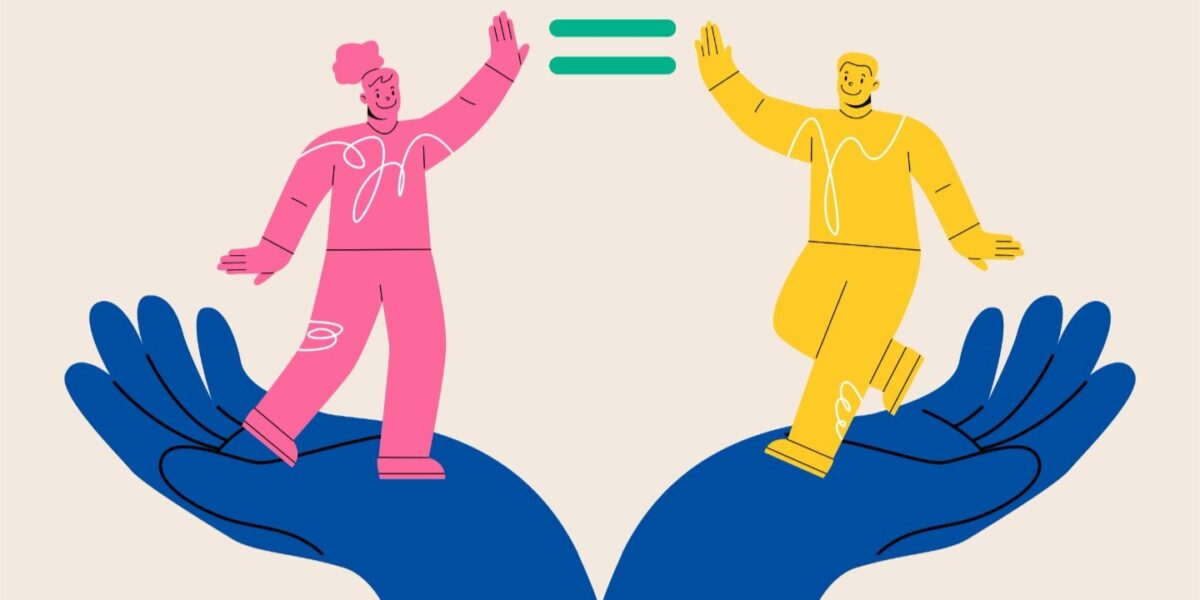
« Aujourd’hui qui oserait prétendre qu’une femme manager n’est pas aussi performante qu’un homme ? Qui s’avancerait à dire qu’il est normal qu’une femme gagne moins qu’un homme quand leur travail est de même nature tout comme leurs diplômes ou leur expérience ? Qui légitimerait l’idée qu’il y a des domaines professionnels réservés aux hommes et d’autres aux femmes ? (…) Alors pourquoi, aujourd’hui, les femmes gagnent-elles, en moyenne, 23,8% de moins que les hommes ? Pourquoi sont-elles moins promues ? Pourquoi, au grand jeu de testing de CV, les hommes gagnent-ils systématiquement, sauf dans des domaines peu attractifs financièrement et jugés strictement féminins comme aide-ménagère ou auxiliaire de crèche ? »
La raison, d’après les autrices de ces lignes, est à chercher du côté de la méconnaissance des salariés comme des entreprises des lois qui garantissent l’égalité femmes-hommes au travail. Dans un récent ouvrage*, Mélanie Duverney Pret, Marie-Hélène Joron et Véronique Mahé défrichent des textes de loi essentiels pour garantir l’égalité professionnelle. Nous recensons ici dix points de droit souvent méconnus.
L’obligation d’affichage des employeurs
Selon l’article R.3221-2 du Code du travail, toute entreprise est tenue de porter à connaissance de ses employés et des candidats à l’embauche, par voie d’affichage, sur son intranet ou par document transmis à chacun :
- Les articles du Code du travail et du Code pénal portant sur l’égalité des rémunérations femmes-hommes, la non-discrimination et le harcèlement moral et sexuel
- La procédure de recueil des signalements pour les lanceurs d’alerte ainsi que la façon dont l’employeur traite ces alertes (dans les entreprises de plus de 50 salariés).
Sur les lieux de travail, l’employeur doit également afficher :
- Les adresses et numéros d’appel où joindre le Défenseur des droits, le référent harcèlement sexuel (dans les entreprises de plus de 250 salariés), le référent CSE harcèlement sexuel, le médecin du travail et l’inspecteur du travail
- Les informations sur la procédure en justice à mener en cas de harcèlement sexuel.
Enfin, l’entreprise doit porter à la connaissance du public, par exemple sur son site internet, sa note obtenue à l’index de l’égalité professionnelle, les mesures prises pour améliorer cette note ainsi que la part de femmes au sein de ses instances dirigeantes.
Le bilan social et la BDESE : des données chiffrées pour mettre à jour les inégalités de traitement
Ces bilans destinés à mesurer l’évolution de l’égalité femmes-hommes au sein de l’entreprise doivent être régulièrement transmis au CSE et aux délégués syndicaux.
Le bilan social doit être établi tous les ans dans les entreprises d’au moins 300 salariés (article L.2312-28 et suivants du Code du travail). Il comporte des informations sur la part de femmes et d’hommes parmi les employés, le type de leurs contrats, leur rémunération, leurs conditions de travail, leurs formations, leurs évolutions professionnelles… Ce bilan est transmis à l’inspection du travail, assorti d’un avis du CSE. Tout salarié peut demander à le consulter en se rapprochant des représentants du personnel.
La BDESE (La base de données économiques, sociales et environnementales), obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés qui ont un CSE, comprend une rubrique dédiée à l’égalité professionnelle femmes-hommes (article L.2312-18 du Code du travail). On y trouve des indicateurs tels que la répartition des effectifs par sexe et qualification, la liste des actions de formation, de bilan de compétences et de VAE, les écarts salariaux…
L’interdiction de spécifier un sexe sur une offre d’emploi
La loi prévoit que tous les métiers doivent être ouverts aux hommes et aux femmes. Il est donc illégal de préciser le sexe du candidat attendu sur une offre d’emploi (article L.1142 du Code du travail) de même qu’il est interdit d’écarter une candidature féminine pour la simple raison qu’un employeur ne veut pas recruter une femme à ce poste. Sur l’offre d’emploi, le poste doit donc être annoncé de manière neutre (« un ou une assistant(e) de direction ») ou bien en utilisant les deux genres (« assistant ou assistante de direction »).
Seules exceptions à ce principe : les offres destinées aux artistes, modèles ou mannequins.
Les documents interdits à demander dans le cadre d’un processus de recrutement
Un employeur n’a pas le droit de demander au candidat des documents contenant des informations sur sa situation familiale : il est donc interdit de lui demander, dans le cadre du processus de recrutement, son livret de famille ou son attestation de carte Vitale (article L.1221-6 du Code du travail).
La parité dans les élections professionnelles
Les listes présentées par les organisations syndicales dans le cadre des élections professionnelles doivent contenir une proportion de femmes candidates égale à la part de femmes dans l’effectif total de l’entreprise. A titre d’exemple, une entreprise de 100 salariés comptant 75 femmes pour 25 hommes devra élire 4 représentants du personnel, dont 3 femmes pour 1 homme.
L’entretien professionnel après un congé maternité ou parental
L’article 1225-57 du Code du travail stipule qu’un collaborateur, de retour de congé maternité, d’adoption ou parental doit être convié à un entretien professionnel par son employeur. L’occasion de faire le point sur sa reprise du travail, de voir si des besoins de formation émergent…
La garantie de rattrapage salarial
La loi du 23 mars 2006 a mis en place une garantie de rattrapage salarial : elle donne le droit à toute collaboratrice de retour au travail après un congé maternité ou d’adoption d’être augmentée dans la même proportion que l’augmentation collective ou la moyenne des augmentations individuelles accordées aux salariés de la même catégorie professionnelle que la sienne, durant son absence.
Le référent harcèlement sexuel
Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises d’au moins 250 salariés ainsi que tous les CSE, doivent nommer un référent harcèlement sexuel. Le rôle de cette personne est de recueillir les signalements, d’orienter et d’accompagner les victimes de harcèlement sexuel.
L’accord d’entreprise ou le plan d’action sur l’égalité professionnelle femmes-hommes
Chaque employeur doit signer avec les représentants syndicaux un accord d’entreprise comprenant des actions en faveur de l’égalité professionnelle femmes-hommes. En l’absence d’accord ou de représentants syndicaux, l’employeur doit adopter un plan d’action contenant le même type de mesures.
Au sein de l’accord d’entreprise ou du plan d’actions, on doit trouver des objectifs et des mesures concrètes en matière d’égalité professionnelle sur chacun de ces sujets (article L.2242-17 du Code du travail) :
- L’embauche
- Les conditions de travail
- Les perspectives de carrière et de promotion
- La rémunération
- La qualification
- La classification
- La santé et la sécurité
- L’articulation vie professionnelle et vie familiale
- La formation
- La mixité des emplois.
La protection des salariés à temps partiel
En 2021, 28,1% des femmes travaillent à temps partiel contre 7,6% selon l’Insee. Une situation qui contribue à creuser les écarts salariaux entre les sexes. La loi précise qu’un employeur ne peut jamais imposer à un salarié de passer à temps partiel, sauf pour des raisons économiques qui sont à prouver.
A l’inverse, si un salarié demande un temps partiel, l’employeur peut refuser seulement s’il se base sur des raisons objectives, par exemple, parce que ce nouveau rythme de travail nuirait au bon fonctionnement de l’entreprise.
Pour limiter le temps partiel subi, la loi prévoit qu’un employeur ne peut pas proposer à un salarié un temps partiel de moins de 24h par semaine (sauf si la convention collective fixe un plancher inférieur) et que ces horaires doivent être le plus possible regroupés sur la journée. En revanche, dans le cas d’un temps partiel choisi, le salarié peut demander à effectuer moins de 24h de travail hebdomadaire.
*L’égalité femmes-hommes au travail – les doits des femmes en milieu professionnel de A à Z de Mélanie Duverney Pret, Marie-Hélène Joron et Véronique Mahé aux éditions Gereso, deuxième édition, février 2024.
Guide du recrutement 2026 : l'indispensable pour bien recruter


