Limites au droit de grève : que dit la loi ?
Alors que certaines voix appellent à tout bloquer le 10 septembre, on fait le point sur les règles qui encadrent le droit de grève avec David Guillouet, avocat.
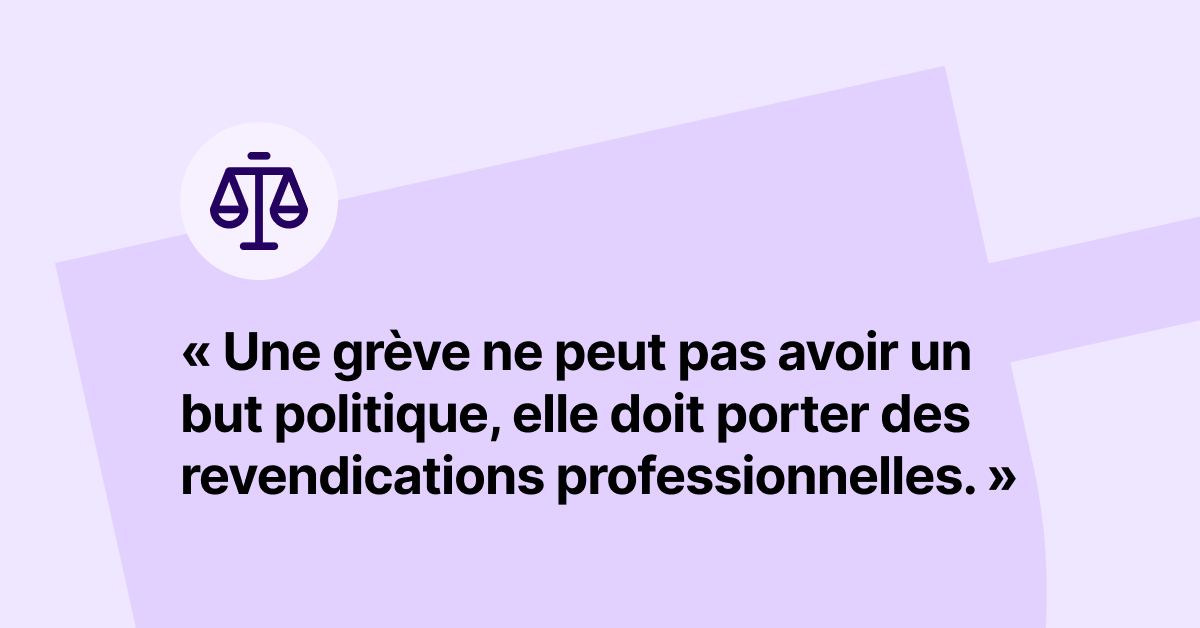
Avant même les premières annonces de François Bayrou sur le budget 2026, plusieurs voix avaient appelé, sur les réseaux sociaux, à bloquer le pays le 10 septembre. Certains syndicats et personnalités politiques ont, depuis, apporté leur soutien au mouvement. Quant à l’intersyndicale, composée de la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT, FO, la FSU, l’Union syndicale Solidaires et de l’Unsa, elle a appelé à une journée de mobilisation nationale, le 18 septembre. On fait le point sur le droit de grève et les marges de manœuvre de l’employeur en cas d’abus.
La grève, un arrêt du travail collectif et concerté
« La jurisprudence définit la grève comme un arrêt du travail collectif et concerté », détaille Me David Guillouet, avocat associé au sein du cabinet Voltaire Avocats. « Il s’agit certes d’un droit individuel, mais le mouvement n’est licite que s’il y a plus d’un salarié gréviste dans l’entreprise. » Seule exception : si le salarié rejoint un appel à la grève national, il peut être l’unique gréviste de son entreprise.
Tout travailleur peut décider de faire grève à l’exception des :
- fonctionnaires de police ;
- surveillants de prison ;
- compagnies républicaines de sécurité (CRS) ;
- magistrats judiciaires ;
- militaires.
Autre règle : la contestation doit porter des revendications professionnelles à la connaissance de l’employeur par tout moyen. Mais pas forcément en amont de l’arrêt du travail : dans le secteur privé, aucun préavis n’est requis. En revanche, dans le secteur public et dans des entreprises comme la SNCF et la RATP, un préavis doit être déposé 5 jours francs avant le début de la grève.
Enfin, une grève suppose une cessation complète du travail. « Une grève perlée, par exemple un contrôleur de train qui ne contrôlerait qu’un voyageur sur deux, ou une grève du zèle, qui consisterait, par exemple, pour un agent de sécurité, à fouiller de fond en comble tous les bagages afin de ralentir sciemment le trafic, sont dites ‘’illicites’’ », illustre Me Guillouet.
Quelles obligations de l’employeur dans le cadre d’une grève ?
Pendant la grève, les grévistes bénéficient d’une immunité et ne peuvent être licenciés que s’ils commettent une faute lourde, « par exemple s’ils tentent de dégrader l’entreprise ou en cas de voie de fait entre salariés [c’est-à-dire des actions telles que des violences ou des menaces qui portent atteinte à la liberté fondamentale de travailler] ».
« En principe, les salariés grévistes ne peuvent pas être remplacés par des CDD ou des intérimaires, complète l’avocat. Mais l’entreprise peut décider de faire appel à des salariés non-grévistes ou bien à des sous-traitants pour accomplir leurs tâches. »
Quels recours de l’employeur en cas de mouvement de grève illicite ?
Deux cas de figure peuvent se présenter :
- soit la grève illicite n’a pas d’impact sur le fonctionnement de l’entreprise : l’employeur peut alors décider de sanctionner directement le comportement d’un salarié, comme en cas de grève du zèle. « Dans les faits, peu d’entreprises font ce choix pour ne pas s’exposer à des risques de contentieux avec leurs collaborateurs », pointe l’avocat.
- soit le mouvement perturbe le fonctionnement de l’entreprise, par exemple en cas de blocage de l’accès à l’entreprise ou d’occupation des locaux : « Dans cette situation, l’employeur peut saisir le juge qui ordonnera la libération des lieux et, si nécessaire, l’intervention de la force publique. Car si la liberté de faire grève est un droit constitutionnel, il faut garder un équilibre entre celle-ci et la liberté de travailler ou d’entreprendre, qui sont aussi des droits constitutionnels. » Ainsi l’employeur doit s’assurer que les collaborateurs qui souhaitent venir travailler puissent le faire et que leur rémunération soit maintenue. En revanche, la rémunération des salariés grévistes est suspendue pendant la durée de l’interruption du travail.
La spécificité du mouvement du 10 septembre
La journée de mobilisation annoncée pour le 10 septembre présente des défis nouveaux : « Historiquement, la grève était encadrée par les organisations syndicales, mais celles-ci sont en perte de vitesse en France et l’on voit émerger, depuis les Gilets jaunes, des mouvements spontanés sur les réseaux sociaux. Ces appels à la mobilisation, aux revendications peu claires et souvent disparates, sans leader et sans mouvement structuré, rendent le dialogue social plus compliqué », souligne Me Guillouet.
Ce dernier rappelle enfin qu’« on ne peut pas se mettre en grève pour une raison purement politique, par exemple pour s’opposer à la politique du gouvernement, mais bien pour porter des revendications professionnelles auxquelles l’employeur doit pouvoir apporter une réponse. »
Guide du recrutement 2026 : l'indispensable pour bien recruter


