Licencier à cause de l’IA : que dit le droit ?
Alors que les plans de départ liés au développement de l’intelligence artificielle se multiplient, on fait le point sur les règles qui encadrent ce motif de licenciement, en France.
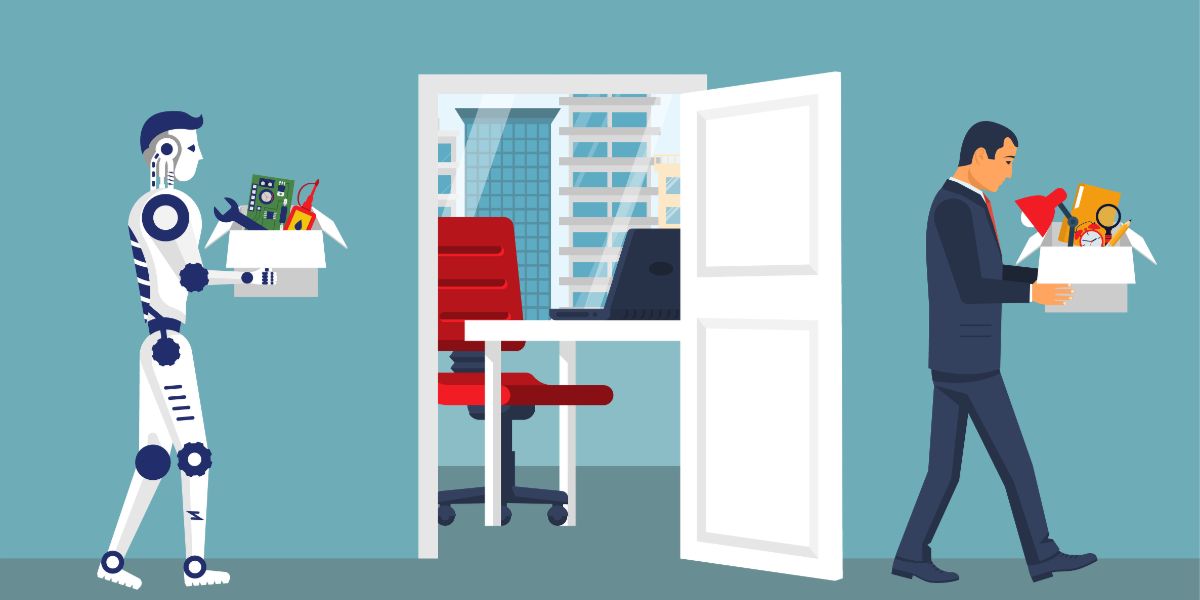
Aux Etats-Unis, Amazon a annoncé, lundi 27 octobre, la suppression de 14 000 postes. Une décision pleinement assumée par son PDG, Andy Jassy, qui explique que l’intelligence artificielle conduit l’entreprise « à réduire le nombre total de ses effectifs » dans les années qui viennent. Cette annonce vient amplifier un mouvement déjà à l’oeuvre depuis quelques mois.
Cet été, le cabinet de conseil Accenture s’est séparé de 12 000 employés que la direction jugeait incapables de s’adapter à l’IA. En mai dernier, Microsoft annonçait réduire d’environ 3 % ses effectifs, ce qui représente 6 000 collaborateurs, au nom des transformations technologiques induites par l’IA.
Le phénomène n’épargne pas la France : annoncé en septembre 2024, le plan de sauvegarde de l’emploi d’Onclusive est le premier cas médiatisé de licenciement imputable à l’IA dans l’Hexagone. L’entreprise de veille médiatique justifiait alors sa volonté de supprimer 217 postes sur 383 par « l’apport de l’intelligence artificielle, mais aussi la modernisation significative de nombreux systèmes et infrastructures obsolètes ». En avril 2025, l’hebdomadaire Le Point dévoilait, quant à lui, un projet de plan social entraînant la suppression de 58 postes, dont des correcteurs qui seront remplacés par des outils d’IA.
Mutation technologique ou sauvegarde de la compétitivité ?
Les suppressions d’emploi liées à l’introduction de l’intelligence artificielle s’inscrivent nécessairement dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, qui doit reposer sur un motif économique, resitue Me Claire Dufils, avocate spécialisée en droit du travail au
sein du cabinet Taylor Wessing : « Deux motifs figurant à l’article L. 1233-3 du Code du travail peuvent être invoqués par les entreprises qui considèrent que les tâches réalisées par leurs collaborateurs peuvent être entièrement prises en charge par une IA : les mutations technologiques et la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Dans les deux cas, l’employeur doit être en mesure de prouver le motif économique. Par exemple, si l’entreprise se place sur le terrain de la sauvegarde de la compétitivité, elle doit prouver qu’elle perdra nécessairement en compétitivité par rapport aux autres entreprises du secteur qui auraient, par exemple, déjà procédé à des réorganisations pour augmenter leur productivité et réduire leurs coûts. »
« Dans le cas d’Onclusive France, la direction avait d’abord invoqué le motif de la mutation technologique. Mais, après échange avec l’administration, elle a finalement renoncé et présenté un nouveau plan de sauvegarde de l’emploi au motif d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, probablement parce qu’il était plus difficile
de prouver que la mutation technologique allait avoir une conséquence directe et avérée sur l’emploi au sein de l’entreprise (suppression des tâches humaines ou que celles-ci pourraient être entièrement automatisées grâce à l’IA). »
Quelles obligations de l’employeur en cas de licenciement pour motif économique ?
Quel que soit le motif choisi, l’employeur est tenu de respecter les étapes de la procédure de licenciement pour motif économique, en fonction du nombre de postes supprimés et de la taille de l’entreprise :
- Si un seul salarié est concerné par le projet de licenciement : convocation à un entretien préalable, envoi d’une lettre de licenciement et notification à l’administration ;
- Si 2 à 9 salariés sont concernés par le licenciement sur une période de 30 jours : information et consultation du CSE, convocation à un entretien préalable, envoi d’une lettre de licenciement et notification à l’administration ;
- Si plus de 10 salariés sont concernés par le projet de licenciement sur une période de 30 jours, la procédure varie en fonction de l’effectif de l’entreprise. Si elle compte moins de 50 salariés, les étapes sont les suivantes : information et consultation du CSE, convocation à un entretien préalable, envoi d’une lettre de licenciement et notification à l’administration. Si elle compte 50 salariés ou plus, l’entreprise a l’obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
« Dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, l’employeur a une obligation de reclassement. Avant d’envisager le licenciement, il doit avoir fait tout son possible pour reclasser en France les salariés dont les postes sont supprimés et il doit pouvoir démontrer qu’il a satisfait à son obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail dans le cadre de ce nouveau contexte technologique », rappelle l’avocate.
Quels risques de contentieux liés à l’IA ?
« Les suppressions d’emploi constituent le principal risque de contentieux lié à l’IA au travail », constate Claire Dufils. Un cas que vient illustrer cette jurisprudence de 2023 : un salarié protégé, membre du CSE, travaillant dans une agence marketing, avait été licencié. Or il contestait le motif économique invoqué par son employeur, à savoir la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise : « La cour administrative d’appel a donné raison à l’entreprise, considérant que la société avait fourni des éléments suffisants pour établir la menace pesant sur sa compétitivité, justifiant ainsi le licenciement. En l’espèce, il y avait eu une évolution au sein du secteur d’activité, car l’IA permettait d’automatiser le recueil et l’analyse de données, et que d’autres entreprises marketing avaient déjà modifié leurs méthodes au vu de cette évolution technologique », résume l’avocate.
Un autre risque de contentieux porte sur la modification du contrat de travail : « Certes, l’employeur dispose d’une certaine latitude dans le cadre de son pouvoir de direction
pour modifier les missions du salarié, mais ces changements doivent s’effectuer dans le périmètre de la fiche de poste et correspondre aux qualifications du salarié. En cas de modification d’un élément essentiel du contrat de travail, c’est-à-dire une modification telle
qu’elle entraîne in fine une suppression du cœur de métier des salariés concernés, l’accord du salarié préalablement à la modification contractuelle est nécessaire », explique Claire Dufils.
Enfin, l’employeur doit également être vigilant quant aux risques psychosociaux associés à l’introduction de l’IA dans l’entreprise : « Les salariés peuvent être stressés s’ils sentent que leur poste est menacé, ils peuvent aussi se sentir isolés et dépassés s’ils ne sont pas formés à ces nouveaux outils. L’employeur doit également veiller au respect des règles en matière de
surveillance via des outils d’IA et veiller à la protection des données personnelles des salariés », liste l’avocate.
Comment limiter les risques de contentieux en tant qu’employeur ?
Pour limiter le risque de contentieux, la formation des managers et des salariés à l’IA est primordiale, selon l’experte : « L’IA prend une place tellement importante dans nos vies professionnelles que les entreprises doivent faire en sorte que tous leurs collaborateurs, peu ou très qualifiés, se sentent concernés et accompagnés dans cette transition. » Pour ce faire, elle conseille de s’appuyer sur des organismes de formation spécialisés en intelligence artificielle.
L’autre clé est de préserver la qualité et la transparence dans le dialogue social : « Les entreprises doivent se faire accompagner juridiquement pour savoir dans quel cas de figure et à quel moment elles doivent consulter leurs instances représentatives du personnel et préserver le climat social. Ces discussions ouvertes permettront de définir collectivement des solutions pour engager l’entreprise dans une transition durable et éviter, autant que possible, les suppressions d’emploi. »
Guide du recrutement 2026 : l'indispensable pour bien recruter



