Index de l’égalité professionnelle femmes-hommes : à quoi pourrait ressembler la nouvelle version ?
Cinq ans après la création de l’index, le HCE a publié de nombreuses recommandations pour sa mise à jour.
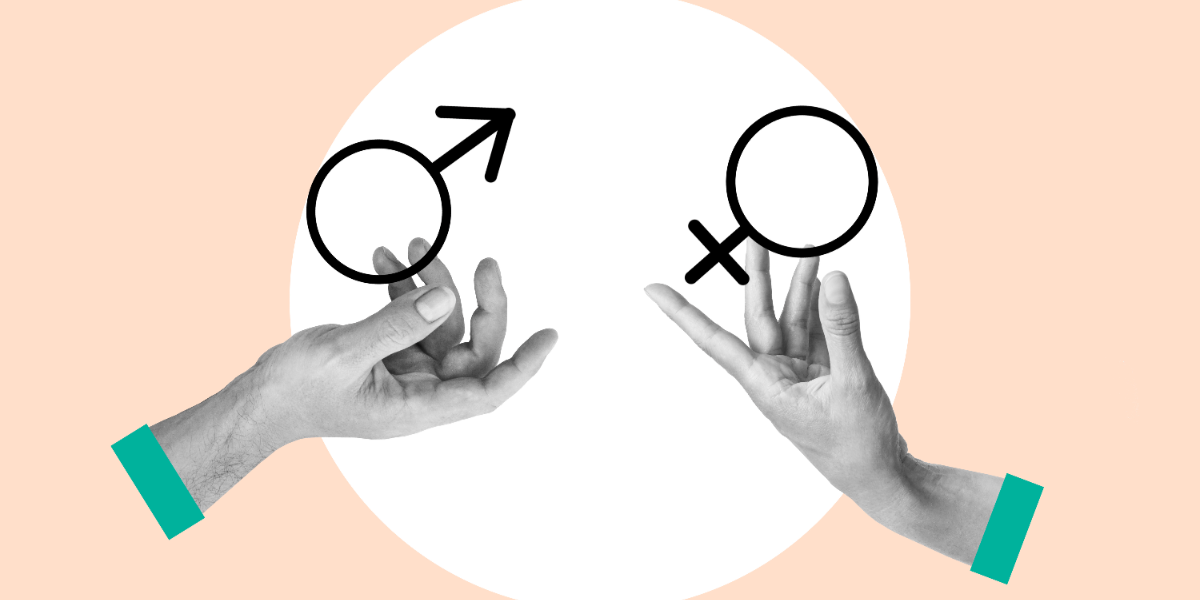
Pas convaincu. Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) a publié le 7 mars 2024, son bilan de l’index égalité professionnelle, dit « index Pénicaud », 5 ans après sa création. L’instance consultative indépendante rattachée à Matignon et créée sous la présidence de François Hollande a ainsi souligné le même jour, dans un communiqué de presse, que l’index n’avait « malgré des avancées indéniables, […] pas rempli toutes ses promesses. »
Un bilan mitigé après un an d’évaluation
Composé de cinq indicateurs portant sur différents facteurs d’inégalité salariale, l’index attribue une note de 100 points aux entreprises. Largement critiqué pour ses imperfections, notamment par les recruteurs eux-mêmes, il couvrait, en 2023, une proportion « très modeste » d’entreprises, selon le HCE. Mise en œuvre coûteuse, index incalculables… : l’année passée elles étaient seulement 1% à y être assujetties. Dans son bilan, l’instance partage également le score moyen des entreprises en 2023 : 88/100, c’est deux points de plus qu’un an plus tôt. Et, sur les 35 000 sociétés assujetties, 7,6% ont obtenu un score inférieur à 75/100.
Pendant près d’un an, les membres de la formation spécialisée en matière d’égalité professionnelle du HCE, qui a repris les missions de l’ancien CSEP (Conseil Supérieur à l’égalité professionnelle), ont évalué l’index dans l’intention de le renforcer, notamment sur trois points : « périmètre, méthodologie (neutralisation des temps partiels, rémunération variable), concept de « valeur égale ». » Composée de représentants des partenaires sociaux (organisations syndicales et patronales) et d’experts, elle traite des questions en lien avec l’égalité professionnelle et est consultée sur les projets de textes légaux ou réglementaires relatifs à ce sujet.
Les quatre pistes d’amélioration qui ont fait consensus
Ce rapport, voté à l’unanimité des suffrages exprimés – avec l’abstention du patronat, précise le HCE – dévoile une série de recommandations d’évolutions de l’index. Au terme des échanges entre les organisations syndicales, patronales et les experts, trois grandes catégories de positionnement ont été recensées afin de présenter les résultats du diagnostic : les pistes d’évolution dégageant un clair consensus, celles qui ont reçu une majorité d’avis favorables et celles n’ayant fait émerger aucune forme de consensus.
Dans le rapport, seules les pistes consensuelles sont largement détaillées. Les voici :
« Maintenir un outil de mesure multifactoriel des inégalités salariales »
Plusieurs pistes sont envisagées pour cette première recommandation dont l’introduction de nouveaux indicateurs dans l’index (le temps partiel dans l’appréciation des écarts de rémunération, aller plus loin que la directive européenne du 10 mai 2023 sur la transparence salariale concernant la mesure du poids des femmes et des hommes dans les bas salaires), la suppression des règles d’exclusions d’effectifs du calcul de l’index ainsi que le seuil de pertinence de 5% réduisant l’écart final calculé, l’évolution des méthodes de calcul des indicateurs n°1/2/3/ de l’index actuel et, enfin, l’alignement des nouvelles mesures de la directive sur les seuils de l’index, à savoir les entreprises à partir de 50 salariés, sur une fréquence de publication annuelle.
« Confier aux pouvoirs publics l’automatisation du calcul de l’index »
Dans son bilan, le HCE constate que la charge administrative de l’index est trop importante pour les entreprises, en particulier pour les PME. Au-delà de l’allègement de cette charge, il vise une baisse du nombre d’index non déclarés et déclarés incalculable afin de redonner confiance entre les parties prenantes de l’entreprise autour des calculs. Pour ce faire, l’instance préconise : une augmentation des moyens des services territoriaux de l’Etat pour accompagner les entreprises et mener un contrôle efficace, le renforcement des obligations et des sanctions administratives autour de la déclaration de l’index « pour réellement inciter à l’atteinte des résultats » et des sanctions judiciaires en cas d’inégalité de rémunération constatée.
« Renforcer la lisibilité et la transparence des indicateurs d’écart de rémunération »
Si le HCE se félicite que l’index soit un premier pas vers la transparence, il constate des marges de progrès quant à sa lisibilité et sa visibilité : « qu’il s’agisse des modalités d’affichage par les entreprises ou des campagnes de services de l’Etat, la communication des résultats doit permettre de flécher plus clairement les actions à mener pour accélérer la réduction des inégalités de rémunération. »
Voici les pistes envisagées :
- introduire des obligations de forme concernant la présentation des données permettant de comparer en chiffres globaux et en pourcentage les populations de préférence
- afficher la note de l’index dans les offres d’emploi internes et externes
- mettre en place un index au niveau de l’entité « mère » et de chaque entreprise dans les groupes et les UES (Unités économiques et sociales)
- instituer un « label transparence des rémunérations » pour les entreprises de moins de 100 salariés volontaires.
« Mieux conjuguer les outils de l’égalité professionnelle à l’index »
Les membres du HCE, dans leur diagnostic, constatent une « articulation encore immature entre les différents instruments en faveur de l’égalité salariale, dans lequel se greffe l’index ». L’enjeu ? Réduire les inégalités dans l’entreprise en simplifiant la « boite à outil » de l’égalité professionnelle à leur disposition et en augmentant la lisibilité de rôles de chaque outil ainsi que leur efficacité. Sur ces points, les pistes majoritaires sont les suivantes :
- allouer plus de moyens de sensibilisation et de formation aux acteurs du dialogue social impliqués sur l’index via des formations supplémentaires
- définir de nouveaux modes d’implication des branches professionnelles dans les actions pour agir sur les inégalités de rémunération, avec la mise en place d’un groupe de travail interbranches professionnelles paritaire. Son ambition, évaluer les différents critères d’appréciation de la « valeur égale » des emplois. Une autre action à retenu l’attention des membres : le lancement d’une étude de comparabilité de la pénibilité au travail, en comparant les métiers à prédominance féminine et masculine
- appliquer l’exclusion des marchés publics et concessions selon les résultats de l’index.
La France attendue au tournant
D’autres pistes n’ont pas fait consensus. Elles ont tout de même recueilli une majorité d’avis favorables des membres du HCE :
- l’introduction de nouveaux indicateurs sur le temps partiel et les bas salaires
- la suppression de toutes les règles d’exclusion du calcul du périmètre et du « seuil de tolérance » de 5% d’écart de rémunération
- l’examen non seulement du nombre mais également du montant des augmentations et l’importance des promotions
- l’augmentation du degré d’exigence en matière de résultats, en élevant la note minimale au-dessus de 75 et en conditionnant l’accès aux marchés publics des entreprises à un résultat satisfaisant à l’index (principe d’éga-conditionnalité)
- l’affichage de la note de l’index dans les offres d’emploi
- la définition des « modalités d’implication des branches professionnelles pour les actions sur les inégalités de rémunération, la mixité des métiers, la classification des emplois… ».
Ce bilan détaillé retiendra probablement l’attention du gouvernement, alors que la directive européenne sur la transparence salariale devrait être transposée en France l’année prochaine. Une « opportunité dans la réflexion que propose ce rapport sur les évolutions à envisager pour l’index » souligne le HCE. Pour rappel, cette directive vise à renforcer l’application du principe d’une même rémunération « pour un même travail ou un travail de valeur égale » et doit être appliquée dans les Etats membres, avant le 7 juin 2026.
Guide du recrutement 2026 : l'indispensable pour bien recruter



