Transformation des métiers : 5 questions que l’IA générative pose aux entreprises
Comment anticiper au mieux les impacts d’une technologie en constante évolution ?
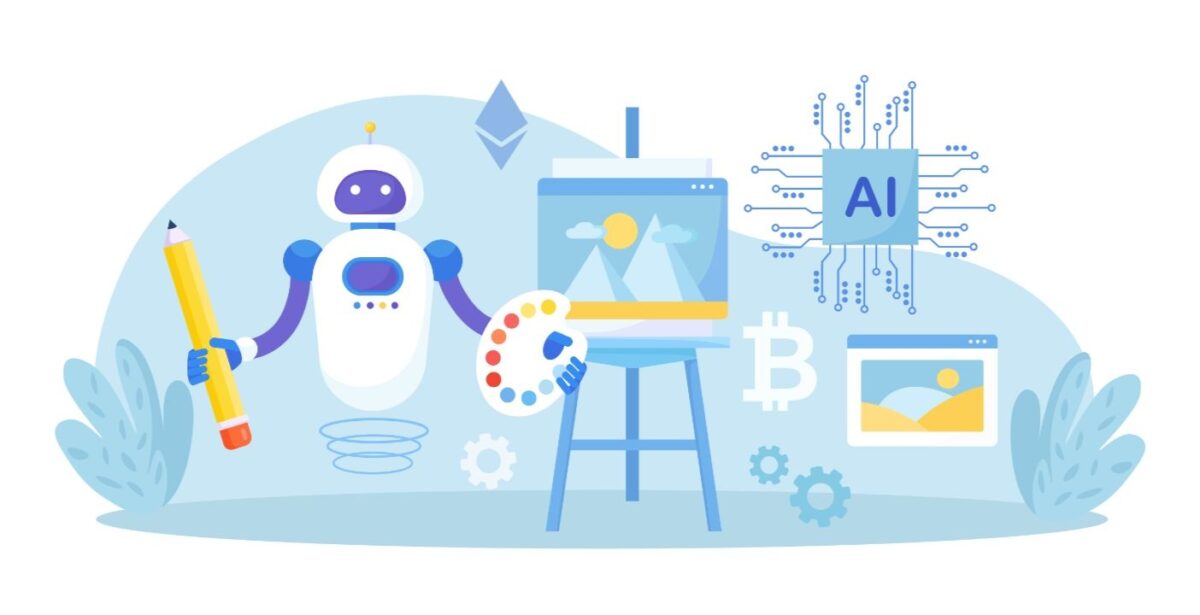
« 2028. Le directeur général de ProdMax, une ETI qui fabrique des équipements complexes pour des sociétés de production a mis en place une task force pour développer l’utilisation de l’IA générative. Des investissements conséquents ont permis de mettre en place des assistants virtuels, capables de guider les opérateurs dans toutes leurs tâches du quotidien, mais aussi des assistants IA à destination des managers pour les épauler dans la gestion d’équipe. Cette nouvelle organisation permet de dégager d’importants gains de productivité et de réduire la masse salariale. »
« Mais, au fil du temps, apparaissent des erreurs qui érodent la confiance des équipes dans l’outil, car, in fine, ce sont les opérateurs qui se font taper sur les doigts. Les licenciements un peu hâtifs provoquent des dysfonctionnements, les gens sont de plus en plus critiques, de moins en moins enthousiastes. Une nécessité de mieux réguler le recours à l’IA s’impose, alors que s’installe un désintérêt pour certains métiers où l’IA a grignoté sur les tâches les plus stimulantes. »
Ce scénario fictif, basé sur des études scientifiques et des enquêtes de terrain, a été présenté le 5 juin au festival « Et demain ? », par le collectif Le Coup d’Après, spécialisé dans la prospective et le design fiction. Croisées avec les premières études sur l’impact de l’IA générative sur le monde du travail, ces hypothèses font germer plusieurs questions que les entreprises vont se poser, si elles ne se les posent pas déjà.
Le recours à l’IA générative devient-il incontournable en entreprise ?
« On peut légitimement se demander si une entreprise qui n’investit pas dans l’IA générative, qui ne forme pas ses salariés à ces technologies ne sera pas considérée comme has been », avance Matthieu Gioani, designer stratégique au sein du collectif.
L’IA générative s’instille dans tous les secteurs d’activité, du fait d’un éventail de plus en plus large de cas d’usages : création de contenus, analyse de données, synthèse ou explicitation de contenu, génération d’idées, recherche d’informations, automatisation de tâches, génération de code informatique…
« Même s’il est vrai que certains métiers sont plus touchés que d’autres par ces transformations, à terme, tous les métiers seront impactés, de près ou de loin par l’IA générative », estime Stéphane Campion, responsable des relations externes IA et Data chez France Travail.
Selon l’étude américaine “New Work, New World”, conduite par Cognizant en partenariat avec Oxford Economics et publiée le 10 janvier 2024, l’IA générative devrait transformer 9 métiers sur 10, d’ici 2032, sur un panel de 1 000 professions.
Pour quelles tâches utiliser l’IA générative ?
Plusieurs critères sont pertinents pour définir le champ d’application de l’IA au sein de son entreprise. A commencer par la performance de la technologie sur une tâche donnée. Au fil des tests, chacun peut se faire une idée des tâches sur lesquelles la technologie s’avère la plus performante et de celles pour lesquelles elle rencontre des limites et n’apporte rien, voire dessert, l’action humaine. Comme nous l’expliquait Donatien Mahieu, chargé de recrutement IT : « Tout comme un élève aura du mal à progresser si son professeur est mauvais, tout dépend de la manière dont le LLM (large language model) a été entraîné. »
Autre option proposée par le MIT : raisonner en termes de coûts : une étude parue en février 2024 passe au peigne fin 1 000 tâches, en vue de comparer le coût de leur automatisation au salaire touché par un employé effectuant la même mission. Résultat : la substitution de l’IA aux salariés n’est rentable que pour 23% des travailleurs observés dans le cadre de cette étude.
L’IA est-elle un facilitateur ou un concurrent du travailleur ?
Le rapport d’enquête de LaborIA Explorer, le laboratoire créé à l’initiative du ministère du Travail et de l’Inria pour mesurer l’impact de l’IA sur le travail, fait apparaître un « conflit de rationalité ». Avec, d’une part, des employeurs qui envisagent l’IA générative comme un « assistant utile » pour « optimiser les process, de réduire les erreurs, ou encore d’améliorer la performance et d’accroître la productivité » et, de l’autre, des employés, préoccupés par les changements annoncés sur « leurs tâches, leurs compétences et leurs conditions de travail », qui soulèvent des questions en matière « de reconnaissance, d’autonomie, de responsabilité et de sens au travail ».
Comment réconcilier ces deux perceptions ? En fléchant les usages vers des solutions qui augmentent les compétences et les aptitudes humaines. Selon les chercheurs, ce compromis peut prendre différentes formes : l’IA réalise des tâches que le salarié ne sait pas ou peu faire, elle le soulage de tâches à faible valeur ajoutée pour le recentrer sur son cœur de métier, elle permet de sécuriser ses pratiques professionnelles en apportant un « second regard », elle favorise l’harmonisation des process de travail, elle repose sur une coopération efficiente homme-machine, sur la base de compétences complémentaires propres à chacun (intuition et expérience pour l’humain, statistiques et probabilité pour l’IA générative).
Quel impact sur le développement des compétences des collaborateurs ?
« La capacité à s’approprier cette technologies, notamment dans les métiers de la créativité, fera certainement la différence en matière d’employabilité », souligne Stéphane Campion.
Au-delà d’apprendre à utiliser l’IA générative de manière optimale, les salariés auront aussi un rôle à jouer dans l’amélioration et le perfectionnement de ces systèmes, du fait de leur caractère apprenant et évolutif, comme le souligne le rapport de LaborIA Explorer : « L’humain est autant ‘’maître d’apprentissage’’ de l’IA que bénéficiaire de sa performance. Cependant, le travail d’entraînement, d’amélioration et de supervision de l’IA, nécessaire à la performance des SIA [systèmes d’intelligence artificielle] et effectué par certains travailleurs, est peu reconnu et valorisé. » D’où l’importance pour les employeurs de redéfinir des critères d’évaluation de la performance en phase avec ce nouvel environnement technologique.
Qui est responsable en cas d’erreur impliquant l’IA ?
Dans le récit imaginé par l’équipe du Coup d’Après, un apprenti, rompu aux usages de l’IA, laisse l’outil rédiger un compte-rendu, ne s’aperçoit pas que ce texte fait l’impasse sur une panne machine et l’envoie tel quel. Cet exemple pose une question : qui sera tenu pour responsable en cas d’erreur impliquant le recours à une IA générative ? L’employé qui a formulé la requête ? L’outil d’IA ? La personne qui a créé son algorithme ? Le salarié qui transmet le résultat obtenu grâce à l’IA ?
« Pour l’instant, seuls les humains peuvent être responsables, rappelle Yann Ferguson, sociologue et directeur scientifique du LaborIA, interviewé par Ouest France. Mais il faut partager cette responsabilité ente l’utilisateur, la manager, le dirigeant et le fournisseur. »
Une bonne manière d’y arriver et de continuer à exercer son esprit critique, tout en se posant des questions sur son propre métier, comme le suggère le recruteur Donatien Mahieu : « Quelle part de rationnel, de subjectivité, d’émotion, d’instinct veut-on mettre dans notre activité ? Certains utilisent l’intelligence artificielle pour neutraliser l’instinct. A mon sens, la bonne démarche est d’utiliser l’IA en exerçant son esprit critique pour confirmer son instinct. »
Guide du recrutement 2026 : l'indispensable pour bien recruter



