Rupture conventionnelle : que dit la justice sur le consentement de l’employeur et du salarié
Depuis une décennie, la justice borne à coup d’arrêts la notion de consentement dans le cadre de la rupture conventionnelle.
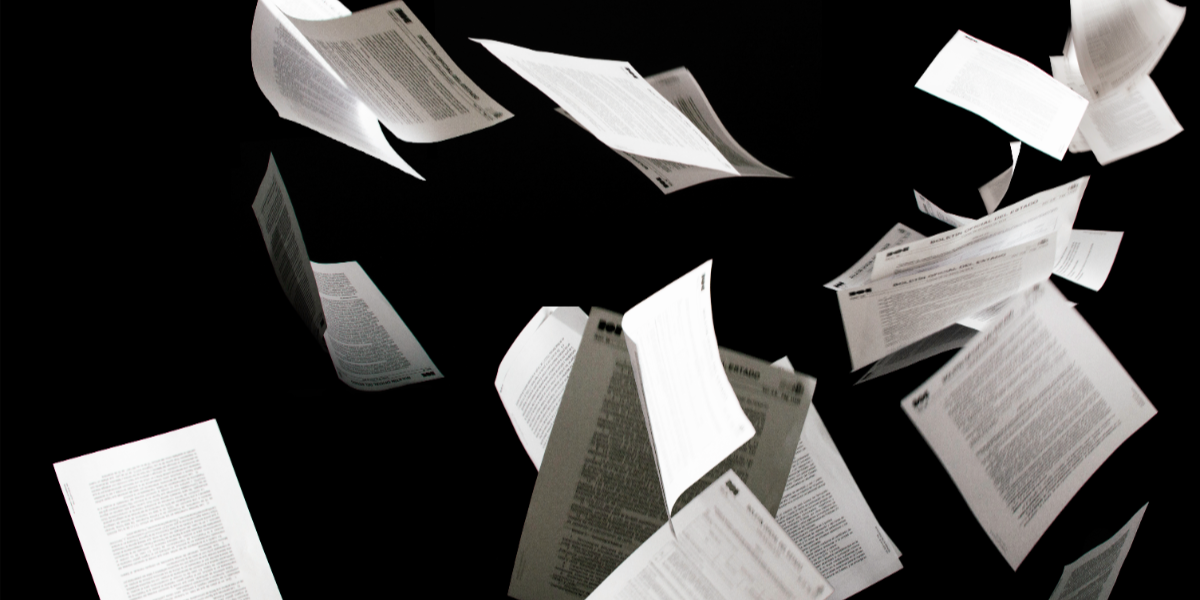
Le succès de la rupture conventionnelle ne faiblit pas. Selon les derniers chiffres de la Dares, publiés en juillet 2024, on en comptabilisait 132 500 au 1er trimestre 2024, en France métropolitaine, sur le champ privé (hors agriculture et particuliers employeurs), une augmentation de 2,3% par rapport au trimestre précédent. L’année passée, elles étaient 514 706. Des chiffres toujours plus à la hausse depuis son introduction dans le Code du travail, en 2008. Si sa suppression a bien été démentie, cet hiver, par la ministre du Travail Catherine Vautrin, le gouvernement envisagerait cependant d’encadrer ce dispositif dans le cadre de son objectif « plein-emploi » (5% de chômage en 2027).
Réservée aux salariés en CDI, la rupture conventionnelle est définie comme « exclusive du licenciement ou de la démission » et « ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties » selon l’article L. 1237-11 du Code du travail. Des contours quelque peu flous, affinés depuis une décennie par la Cour de cassation, qui a, en particulier, précisé la notion de consentement. Des jugements qui ont fait jurisprudence, majoritairement en faveur du salarié. Or, pour la première fois cet été, la Cour de cassation a tranché en faveur de l’employeur. Retour sur les différentes dispositions fixées par la loi et destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Un consentement libre et éclairé du salarié…
Pour tout type de contrat, le consentement libre et éclairé est une condition de validité. Ainsi, lorsque des vices du consentement sont révélés, la nullité du contrat est encourue. L’appréciation de l’existence d’un vice de consentement, qui entacherait la validité de la rupture conventionnelle, relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cour de cassation, arrêt du 16 septembre 2015). En France, ces derniers désignent un magistrat ou un tribunal qui dit et juge les faits ainsi que les droits : les juges du premier (tribunal judiciaire, tribunal de commerce et conseil de prud’hommes) et du second degré (cours d’appel) de juridiction. Au-dessus de ces juridictions du fond se situe la Cour de cassation.
1. Les vices du consentement
Le Code civil définit trois vices du consentement : l’erreur, le dol et la violence. Dès 2014, selon un arrêté de la Cour de cassation, la rupture conventionnelle est valablement conclue « sauf en cas de fraude ou de vice de consentement. »
Le dol est le fait, pour un contractant, d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. L’erreur, en droit des contrats, est définie, quant à elle, comme une fausse représentation de la réalité : la partie qui a contracté dans l’erreur n’aurait pas conclu le contrat, sinon à des conditions différentes, si elle avait eu connaissance de la réalité. Enfin, le Code civil estime qu’il y a violence « lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable » (article 1140). Elle est aussi caractérisée dans le lien de subordination : « Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif » (article 1143).
Sur la question des preuves, la Haute juridiction a statué le 11 mai 2022 : c’est à la partie (employeur ou salarié) qui invoque l’existence d’un vice du consentement d’en rapporter la preuve.
2. Les faits de harcèlement moral
Aussi, selon la Cour de cassation, si à la date de la signature de la rupture conventionnelle, le salarié était dans une situation de violence morale, en raison du harcèlement moral et des troubles psychologiques qui en découlent, le vice du consentement est caractérisé, entrainant la nullité de la convention de rupture (arrêt du 29 janvier 2020).
Or, pour la chambre sociale de la Cour de cassation, la convention ne sera invalidée que si les faits de harcèlement moral ont pour effet un vice de consentement (arrêt du 15 novembre 2023). Le Conseil d’Etat a également tranché sur la question, dans son arrêté du 13 avril 2023 : « L’existence de faits de harcèlement moral ou de discrimination syndicale n’est pas de nature, par elle-même, à faire obstacle à ce que l’inspection du travail autorise une rupture conventionnelle, sauf à ce que ces faits aient, en l’espèce, vicié le consentement du salarié. »
Dans une affaire opposant une chargée de recrutement à son employeur, suite à une rupture conventionnelle de son contrat de travail en juin 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’employeur et confirmé la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en faveur de la salariée : « La cour d’appel a souverainement estimé que la salariée était, au moment de la signature de l’acte de rupture conventionnelle, dans une situation de violence morale du fait de harcèlement moral dont elle a constaté l’existence, résultant notamment de propos déplacés réguliers, voire quotidiens, de nature discriminatoire et des troubles psychologiques qui en sont résulté. Elle en a exactement déduit que la convention de rupture était nulle » (1er mars 2023).
3. La question du différend
Les conflits et désaccords entre le salarié et son employeur n’affectent pas non plus la validité de la convention. A cet effet, la Cour de cassation a tranché le 23 mai 2013 :
Dans cette affaire, l’employeur reprochait à l’une de ses salariées, avocate, des manquements professionnels qui justifiaient, selon lui, un licenciement. Or, soucieux de préserver des relations confraternelles, il lui avait proposé une rupture conventionnelle, conclue en juin 2009. Cette dernière avait alors saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats et demandé la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Deux arguments sont invoqués par la cour d’appel de Versailles pour accueillir la demande de la salariée : l’existence d’un litige entre les parties relatif à l’exécution du contrat de travail et le vice du consentement caractérisé des menaces et pressions dont la salariée avait fait l’objet, pour la contraindre à choisir la rupture conventionnelle.
Si la Cour de cassation retient bien le vice de consentement, elle écarte le motif de l’existence d’un litige : « Si l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties du contrat de travail n’affecte pas elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L1237-11 du Code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties » (arrêt du 23 mai 2013).
4. Arrêt maladie, accident du travail et inaptitude médicale
Concernant l’inaptitude médicale, la justice a déjà statué à plusieurs reprises. Dans un arrêt du 9 mai 2019, elle a approuvé la possibilité de rompre le contrat de travail via la rupture conventionnelle dans le cas d’un salarié déclaré inapte à la suite d’un accident de travail : « Sauf cas de fraude ou de vice du consentement, une convention de rupture peut être valablement conclue par un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident de travail. » La même décision a été prise, pour un salarié déclaré apte avec réserves à la suite d’un accident de travail (arrêt du 28 mai 2014).
Sur l’arrêt maladie d’origine professionnelle et l’accident de travail, la direction générale du travail (DGT) considère qu’on ne peut signer de rupture conventionnelle lors de ces suspensions : « dans les cas où la rupture du contrat de travail est rigoureusement encadrée durant certaines périodes de suspension du contrat (par exemple durant le congé de maternité en vertu de l’article L 1225-4, ou pendant l’arrêt imputable à un accident du travail ou une maladie professionnelle en vertu de l’article L 1226-9, etc…), la rupture conventionnelle ne peut, en revanche, être signée pendant cette période » (circulaire du 17 mars 2009).
Or, à certaines reprises, les juges se sont alignés sur ce qui était retenu en matière d’inaptitude : « Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l’article L. 1237-11 du Code du travail au cours d’une période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle » (arrêts du 30 septembre 2014 et du 16 décembre 2015).
5. Un cas particulier : l’arrêt maladie d’origine non professionnelle
Pour les employeurs, le bât peut surtout blesser dans le cas de l’arrêt maladie d’origine non professionnelle car, sur le sujet, la jurisprudence est moins fournie. En la matière, la Cour de cassation a tranché le 30 septembre 2013. S’il est possible de conclure une rupture conventionnelle lorsque la maladie est professionnelle, cela l’est aussi lorsqu’elle est non professionnelle. Dans cette affaire, la rupture avait été signée avec un salarié en arrêt depuis huit mois et alors même qu’un différend existait entre les parties (voir plus haut). Le salarié avait fait valoir qu’il était victime de harcèlement moral. Pour la chambre sociale, « il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de l’arrêt que le salarié a invoqué devant les juges du fond des agissements précis de l’employeur susceptibles de laisser présumer un harcèlement moral. […] La cour d’appel a souverainement estimé qu’au moment de la signature de la convention, le consentement du salarié était libre et éclairé. »
Vigilance est tout de même de mise lors de la conclusion d’une rupture conventionnelle avec un salarié dont le contrat est suspendu pour raisons de santé. Dans l’affaire précédemment citée, le salarié, même s’il a été débouté par la justice, avait fait valoir une situation de faiblesse psychologique due à la maladie qui aurait altéré son consentement et ainsi vicié la rupture conventionnelle.
… et de l’employeur
Dans de nombreuses affaires désormais jurisprudences, l’applicabilité ou non du vice de consentement concerne le salarié. S’il est retenu, « l’annulation de la convention de rupture en raison d’un vice du consentement du salarié rend la rupture imputable à l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse » (arrêt de la Cour de cassation du 16 septembre 2015).
En juin 2024, et c’est inédit, la justice s’est prononcée sur le vice de consentement de l’employeur. Les faits étaient les suivants : l’entreprise partie au litige est spécialisée dans la conception et la fabrication d’interface dans le secteur automobile. Après huit ans, le responsable commercial concerné fait part de son souhait de mettre un terme à son contrat. Son employeur ne souhaite pas qu’il quitte l’entreprise et lui propose d’acheter des parts. Après le refus du salarié, une rupture conventionnelle est conclue en novembre 2018 et le contrat rompu le mois suivant. En mai 2019, le salarié crée une société dans le même secteur d’activité et dans les mois qui suivent, la société saisit le conseil de prud’hommes d’Albi en nullité de la rupture conventionnelle.
Dans son arrêt du 19 juin 2024, la Cour de cassation a constaté que « le salarié avait volontairement dissimulé des éléments dont il connaissait le caractère déterminant pour l’employeur afin d’obtenir le consentement de ce dernier à la rupture conventionnelle. » Le contrat étant nul, la Cour a ainsi posé le principe selon lequel « lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée en raison d’un vice du consentement de l’employeur, la rupture produit les effets d’une démission. »
Pour un employeur, c’est l’ouverture sans précédent de la possibilité de remettre en cause des ruptures conventionnelles s’ils estiment que leurs salariés ont dissimulé des informations essentielles à leur consentement.
Guide du recrutement 2026 : l'indispensable pour bien recruter



