Congés payés en arrêt maladie : quels impacts pour les employeurs ?
La Cour de cassation a ouvert la porte à l’acquisition de congés payés pour les salariés en arrêt maladie mais certaines questions restent en suspens.
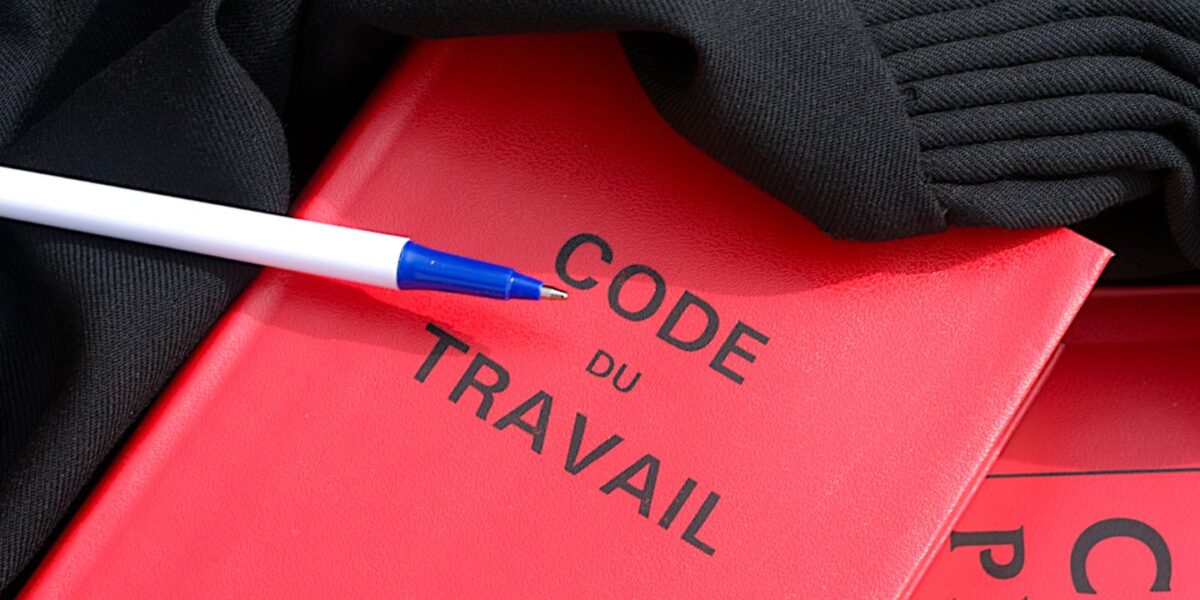
Jusqu’alors, un salarié en arrêt maladie ne cumulait pas de droits à congés payés, sauf en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail. C’est sur le point de changer. Afin de mettre le Code du travail en conformité avec le droit européen, la Cour de cassation a estimé, le 13 septembre dernier, que les arrêts maladie ne devaient pas avoir d’incidence sur le calcul des congés payés du salarié.
Pourquoi une telle décision ?
En principe, le droit du travail français permet aux actifs d’acquérir deux jours et demi de congés payés par mois travaillé. Mais pas en cas d’arrêt maladie (sauf maladie professionnelle ou accident du travail, dans la limite d’un an). En cela, il déroge à deux textes européens : la directive sur le temps de travail de 2003 et la charte européenne des droits fondamentaux de 2009.
Après la condamnation de l’Etat français pour non respect des directives européennes, puis la décision de la Cour de cassation, le gouvernement français a donc annoncé qu’il allait aligner le Code du travail sur le droit européen, au motif que nul ne peut être discriminé en raison de son état de santé.
Les arrêts maladie seront donc considérés comme du temps de travail effectif, donnant droit à des congés payés, au même titre qu’un congé maternité ou paternité, par exemple.
Quand entrera-t-elle en vigueur ?
Pour pouvoir peaufiner le texte, le gouvernement atteint une décision du Conseil constitutionnel qui doit intervenir d’ici mi-février. La haute juridiction a été saisie de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) :
- les dispositions législatives françaises portent-elles atteinte à la santé du salarié, dans la mesure où, sans travail effectif, le salarié n’acquiert pas des droits aux congés payés ? De plus, le droit français ne permet pas l’acquisition de congés payés aux salariés en arrêt pour une maladie professionnelle ou un accident de travail au-delà d’un an. Cette disposition ne porte-t-elle pas atteinte à la Constitution ?
- le droit français ne porte-t-il pas atteinte au principe d’égalité garanti par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, mais aussi par la Constitution, dans la mesure où il fait une distinction entre acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie pour origine professionnelle ou non professionnelle ?
Combien de jours de congés seront acquis pendant la période d’arrêt maladie ?
Une année d’arrêt maladie ouvrira-t-elle le droit à quatre semaines de congés payés (comme préconisé par la directive européenne) ou à cinq semaines (comme le prévoit le Code du travail pour l’ensemble des salariés français) ?
La réponse dépendra de la décision du Conseil constitutionnel. S’il estime que c’est le principe d’égalité qui s’applique, ce sont les cinq semaines du droit français qui seront étendues à tous les salariés en arrêt maladie.
Quand ces congés pourront-ils être pris ?
Il est prévu que le salarié revenu d’arrêt maladie puisse poser ses congés payés, acquis entre le 1er juin et le 31 mai et non pris, dans les quinze mois qui suivent sa reprise du travail.
Le salarié bénéficiera donc des mêmes droits à congés payés que tout collaborateur, y compris si la durée de son arrêt est supérieure à un an. Concrètement, à son retour d’arrêt maladie au bout de trois ans, un salarié ne disposera pas des quinze semaines accumulées sur cette période mais seulement des congés payés acquis au cours des quinze derniers mois.
Combien cela va-t-il coûter aux entreprises ?
D’après le Medef, cette nouvelle règle représenterait un coût de deux milliards d’euros par an. Le 30 novembre, lors du salon Impact PME, la Première ministre, Élisabeth Borne, avait rassuré les chefs d’entreprise, arguant que tout serait fait pour « réduire au maximum » l’impact de cette mesure.
La mesure aura-t-elle un effet rétroactif ?
Il se pourrait que la mesure porte également sur des arrêts de travail passés. Mais, dans quelle limite ? La jurisprudence de la Cour de cassation bénéficie, par principe, d’un effet rétroactif : la prescription des congés payés est de trois ans à compter du jour où l’employeur a pris effectivement des mesures pour permettre à ses collaborateurs d’exercer leur droit à congés payés.
Mais le législateur français pourrait décider de remonter jusqu’au 1er décembre 2009, date à laquelle la charte des droits fondamentaux de l’UE a acquis une dimension obligatoire.
Guide du recrutement 2026 : l'indispensable pour bien recruter



