Assurance-chômage : quels sont les premiers effets de la réforme de 2019 ?
Les nouvelles mesures ont notamment entraîné une baisse significative du nombre d’ouvertures de droits à l’assurance-chômage.
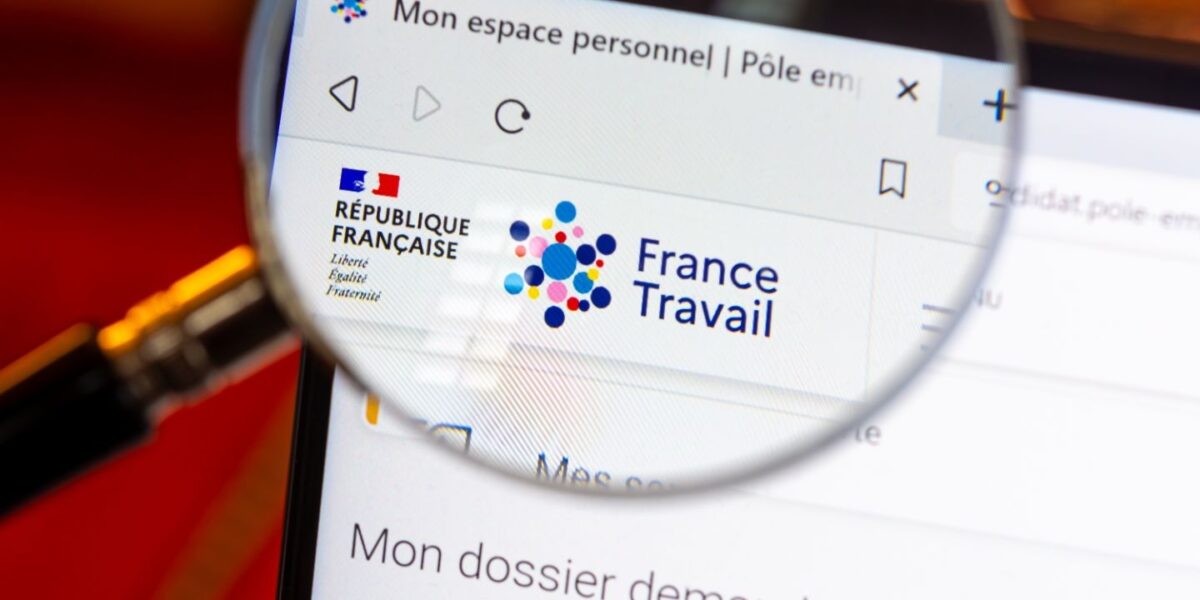
Le Premier ministre, Gabriel Attal, a multiplié, ces derniers jours, les déclarations allant dans le sens d’un nouveau durcissement des règles d’indemnisation de l’assurance-chômage pour « inciter à la reprise d’emploi », alors que le taux de chômage atteignait 7,5% au dernier trimestre 2023. C’est dans ce contexte que la Dares publie, le 27 février, un rapport intermédiaire présentant les premiers impacts de la réforme de l’assurance-chômage de 2019.
En quoi consiste la réforme de 2019 ?
L’objectif poursuivi par cette réforme, entrée en vigueur en 2021, était d’encourager un retour à l’emploi durable. Pour ce faire, quatre leviers ont été actionnés :
- La durée minimale d’affiliation pour pouvoir être indemnisé par l’assurance-chômage est passée de 4 à 6 mois
- La baisse de l’allocation journalière et une augmentation de la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi au parcours fractionné
- Une diminution de l’allocation de 30% au bout de six mois pour les demandeurs d’emploi de moins de 57 ans les mieux rémunérés (au-delà de 4 700€ brut mensuels)
- Un bonus-malus qui module le taux de cotisation chômage des employeurs en fonction du nombre de collaborateurs dont ils se sont séparés.
Quelles conséquences ?
Une baisse du nombre d’ouvertures des droits au chômage
Le rapport montre que ces mesures ont eu un impact significatif sur le nombre d’ouvertures de droits au chômage. Il a, en effet, chuté de 17%, entre 2019 et 2022, principalement chez les jeunes, les moins diplômés et les personnes qui sortaient d’un contrat en CDD ou en intérim.
« Cette diminution est liée à la réforme mais aussi aux dynamiques du marché de l’emploi, nuance Rafael Lalive, président du comité scientifique d’évaluation et professeur d’économie à l’Université de Lausanne. Il faut rappeler qu’en période de pénurie de main-d’œuvre, les salariés transitent plus facilement d’une entreprise à l’autre sans nécessairement passer par la case chômage. »
Un retour à l’emploi peu durable pour les plus de 25 ans
Sans surprise, l’allongement de la condition minimale d’affiliation réduit les inscriptions à France Travail et accroît le retour à l’emploi à la suite d’une fin de contrat de travail de plus d’un mois.
« Cette perte de revenu peut les amener à accepter plus systématiquement les offres d’emploi qui leur sont proposées, au détriment de la qualité de l’emploi retrouvé », estiment les auteurs du rapport. Pour les plus de 25 ans, ce retour à l’emploi prend ainsi la forme d’un contrat peu durable : CDD de moins de deux mois ou mission d’intérim.
6% des entreprises françaises concernées par le bonus-malus
Le bonus-malus a concerné 18 000 entreprises de 11 salariés ou plus la première année, soit 6% des entreprises françaises. Sept secteurs d’activité, qui ont massivement recours à des contrats courts, sont concernés : la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac, le travail du bois et les industries du papier et de l’imprimerie, la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques, la production de distribution d’eau, l’assainissement et la gestion des déchets et la dépollution, les transports et l’entreposage, l’hébergement et la restauration, les autres activités spécialisées, scientifiques et techniques.
Parmi elles, 36% des entreprises sont soumises au malus et 64% bénéficient d’un bonus. « On constate que certaines grandes entreprises en malus choisissent de ne pas changer leurs pratiques d’embauche et décident d’intégrer ce malus comme un coût fixe. D’autres, en revanche, réagissent en embauchant en CDI une partie de leurs intérimaires ou en leur proposant des missions de plus longue durée », souligne Rafael Lalive.
Quelles pistes évoquées par l’exécutif pour la suite ?
Le chef du gouvernement confiait au JDD, le 25 février, « on a passé de 24 à 18 mois la durée d’indemnisation, on peut encore la réduire. On peut aussi accentuer la dégressivité des allocations. »
De son côté, le ministre de l’Économie, Bruno Lemaire, avait proposé un alignement de la durée d’indemnisation des plus de 55 ans, actuellement à 27 mois, sur celle des autres demandeurs d’emploi, qui est de 18 mois.
Guide du recrutement 2026 : l'indispensable pour bien recruter



